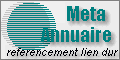Creation Category:
E.O – Henri Meschonnic, vous êtes poète, poéticien, essayiste et traducteur. Est-ce que l’ordre dans lequel je viens de citer vos nombreuses activités vous convient ?
H.M. ï€ Poète, essayiste, traducteur. Oui il y a un ordre et en même temps tout interagit intérieurement. Mais pour autant que je me connais, je suis poète d’abord, et les poèmes que j’écris me font réfléchir sur la poésie, sur le langage, pour fonder la théorie du langage à partir des poèmes comme actes éthiques, qui transforment la théorie des sujets, par quoi aussi, pour moi, si un poème est d’abord un acte éthique, c’est aussi un acte politique, et ainsi la théorie du langage devient une poétique de la société. Et c’est l’écoute du poème qui me fait traduire comme je traduis, et spécialement la Bible. Ainsi toutes ces activités sont les aspects différents d’une seule et même activité, celle du poème.
E.O. –. Avant d’aborder d’autres questions, je voudrais vous demander de bien vouloir préciser deux points que vous venez d’évoquer
a- Un poème est d’abord un acte éthique
b- Le poème comme acte politique
H.M. ï€ Je pose que pour qu’un poème soit un acte poétique, il faut d’abord qu’il soit un acte éthique, parce que je comprends l’éthique comme ce qui met en jeu du sujet, le sujet, tous les sujets que nous sommes comme individus vivant ce que Spinoza appelle « une vie humaine ». Alors un acte éthique est ce qui met en jeu le sujet qui écrit de telle sorte que j’appelle poème une forme de vie qui transforme une forme de langage et, réciproquement, une forme de langage qui transforme une forme de vie. Donc un poème transforme celui qui l’écrit, mais aussi il transforme celui qui le lit. Toute la différence avec la poétisation.
Et comme nous sommes tous des sujets sociaux, nous sommes tous des sujets politiques, ainsi nécessairement un acte éthique est un acte politique, et le poème est un acte politique. Quand Maïakovski écrit un poème d’amour, alors que l’idéologie soviétique pose que l’amour est un sentiment bourgeois décadent, son poème est un acte poétique et politique. Et c’est Mandelstam en 1920, dans un article qu’il intitule « L’État et le rythme », qui dit que si on ne fait pas attention à l’individu on aura le collectivisme sans collectivité.
E.O. – Comment êtes-vous venu à l’idée de traduire la Bible. D’abord les cinq rouleaux et maintenant le Houmach, travail qui renouvelle entièrement la conception de la traduction du texte biblique
H.M. ï€ Question difficile pour moi justement parce qu’elle m’engage du plus profond de mon histoire individuelle, avec mon enfance traquée pendant la guerre, et paradoxalement (je dis paradoxalement parce que la Bible est un texte religieux et hyper-sacralisé) dans une famille non religieuse. Mais le besoin intérieur de réagir, et de me trouve, est passé par l’apprentissage individuel et tardif de l’hébreu biblique. J’ai dû commencer vers vingt ans, je n’y suis vraiment arrivé qu’à vingt-sept, quand j’étais soldat dans la guerre d’Algérie. Je suis un autodidacte et un amateur, pas un professionnel. Je n’arrête pas d’apprendre. J’ai ressenti un choc très fort en découvrant l’original, par rapport aux traductions. Et surtout quand j’ai découvert la grammaire des teamim, je ne me rappelle plus où, mais par bonheur j’ai d’emblée trouvé mon système d’équivalences typographiques pour les trois forces des accents disjonctifs, dès la première traduction qui a paru , c’est Ruth, au printemps 1966, puis Paroles du Sage en 1968 et Le chant des chants en 1969, avant Les Cinq Rouleaux de 1970. Et j’ai continué d’apprendre, avec les Taamei hamiqra de Baruch ben Yehouda (1968) et les deux traités, en anglais, de William Wickes (Ktav, New York, 1970). La visée, je l’ai ressenti tout de suite, c’est de faire entendre le poème de l’hébreu et l’hébreu du poème. Alors, si tout va bien, là j’ai fini bamidbar, et je vais me mettre à devarim, j’ai l’intention de traduire toute la miqra.
Et j’y ai appris des choses importantes, comme la différence entre le sacré, le divin et le religieux. Différence que ne font pas les religieux. Je définis le sacré comme le fusionnel entre l’humain et le cosmique, et incluant l’animal : le serpent parle à Ève ; le divin est le principe de vie (Genèse 1, 20-21) qui se réalise dans toutes les créatures vivantes ; le religieux n’arrive qu’avec vayiqra, c’est la ritualisation de la société (le calendrier des fêtes, les interdits, les prescriptions) et en tant que théologico-politique le religieux peut même être l’ennemi majeur du divin : on tue au nom de Dieu.
Et, ce qui a une importance telle que pour moi la Bible n’est pas une origine mais un fonctionnement, je trouve dans la Bible le fait, dès beréchit, que des mots abstraits comme « la vie » soient le pluriel du concret, « les vivants ». Je viens d’en faire tout un livre, où j’oppose le réalisme des essentialisations au nominalisme des individus d’abord.
E.O. ï€ J’aimerais vous poser quelques questions sur des lieux communs…
a- On a beaucoup parlé de Post-Moderne, je ne sais pas très bien ce que l’on entend par là. Qu’est-ce qui va venir après, Post post moderne ? Je m’imagine que vous avez une opinion là-dessus.
b- J’ai souvent entendu dire que la langue française était moins rythmée que d’autres langues. (J’y ai même cru un moment) Cela ne vous semble-t-il pas une absurdité ?
c- Autre lieu commun, la prose poétique (qu’est-ce ?) serait privée de rythme.
d- L’Internet, un danger pour la poésie.
H.M. ï€ J’ai déjà répondu sur le post-moderne, dans un livre de 1988 qui est ressorti en livre de poche en 2005, et que j’ai appelé Modernité modernité. La notion de post-moderne (à l’origine, en architecture, en réaction contre le modèle dogmatique du moderne), fait partie des déchets de l’époque, et s’est fondé sur l’erreur de croire que le moderne, c’était le nouveau, et que comme après chaque nouveau vient un nouveau nouveau, qui fait que l’ancien nouveau devient périmé, le post-moderne s’est dénommé ainsi contre la modernité des années vingt et après. La seule chose qui peut donc venir après le post-moderne, n’est pas un post post, mais comme toujours, des inventions de pensée et des inventions du regard, et celles-là, comme toujours, restent modernes, et j’entends par modernes actives et présentes au présent indéfiniment. Homère est moderne, des gloires d’il y a vingt ans sont du déchet de l’époque.
b – Le langage est un des domaines où il y a le plus d’idées reçues. L’art aussi. Et l’une des plus grosses erreurs est de croire que chaque langue a un génie, c’est-à-dire, des qualités naturelles, que n’ont pas les autres. Alors on croit que telle langue est plus belle qu’une autre, et a du rythme, par exemple, et d’autres, non.
La langue française est un domaine particulièrement riche en clichés culturels. C’est contre le cliché de la clarté française que j’ai écrit un livre, que j’ai appelé De la langue française, essai sur une clarté obscure (1997, en livre de poche en 2001). Il manque « le génie », exprès, dans le titre. Le génie est une nature. Or les langues sont une histoire, et une histoire qui est celle des discours, des œuvres. Croire au génie d’une langue, c’est attribuer à la langue ce qui est la propriété des discours, des œuvres. Ce sont les œuvres qui sont maternelles, pas les langues. C’est la Bible qui a fait l’hébreu – au sens de ce que l’hébreu est devenu, par la Bible – ce n’est pas l’hébreu qui a fait la Bible. Ce sont les valeurs éthiques, poétiques, politiques qui font une culture, et il ne faut pas attribuer à la langue ce qui est de la culture, et les deux, langue et culture, deviennent inséparables.
Et pour le rythme, on a souvent comparé le français aux autres langues européennes à accent de mot (anglais, allemand, italien, espagnol, etc.), pour dire qu’il n’a pas de rythme, parce que le français n’est pas une langue à accent de mot. Mais c’est une langue à accent de groupe, et donc les accents se déplacent. Si un mot fait un groupe, il a un accent de fin de groupe, si le même mot entre dans un groupe et n’est pas à la fin, il n’a plus l’accent qu’il avait quand il était équivalent à un groupe. De plus il y a les accents d’attaque consonantique. Et les accents d’insistance dans les répétitions, et les accents de position. Il y a le rythme comme organisation du mouvement de la parole, et il y a les rythmes, syntaxiques, prosodiques.
c – Quant à la prose opposée à la poésie, cette ineptie a une longue histoire, et qui n’est pas finie. L’identification culturelle de la poésie au vers, à la métrique, a produit deux erreurs. La première, mais il n’y a pas de hiérarchie, les deux ont cours en même temps, c’est qu’une identification du rythme à la métrique a fait croire, et continue de faire croire à certains que la prose n’a pas de rythme.
Cette illusion se nourrit de l’étymologie du mot vers et du mot prose en latin : le vers est le sillon du paysan qui revient sur lui-même, la prose est le discours qui va de l’avant. Cette première illusion vient du travail conceptuel de Platon, qui a transformé la notion pré-socratique de rythme, mouvement de ce qui s’écoule en continu, en une notion du discontinu, en ajoutant, pour penser la musique, les trois notions d’ordre (taxis), de mesure (metron) et de proportion mathématique (harmonia). Mais dans la réalité même de la prose, c’était faux, car les orateurs attiques avaient une métrique de prose, différente, bien sûr, de celle des fins de vers, et la prose latine avait aussi une métrique des fins de phrase, appelée cursus. Le paradoxe de cette première erreur est que les théoriciens français du XVIIIe siècle ne la font pas, et Shelley en 1817 dans A Defence of Poetry dit que c’est une « erreur vulgaire » d’opposer les écrivains en vers aux écrivains en prose. La deuxième erreur découle de la première et consiste à opposer la poésie à la prose. Le poème en prose, à partir du milieu du XIXe siècle, montre que la poésie ne peut pas, ne peut plus avoir une définition formelle par le vers. Mais cela, Aristote le savait déjà.
d – Je ne sais pas si je comprends bien la question. Autant que je sache, la technologie a un effet d’accélération fantastique de la communication. Avec évidemment des effets bénéfiques. Mais sans rapport avec la qualité de ce qui est communiqué, qui ne change donc rien, à part la vitesse, à ce qu’Ésope, dans l’antiquité grecque, disait de la langue, qu’elle peut véhiculer le meilleur comme le pire. Donc, à mes yeux, cela ne change rien. Sinon que cela apporte une illusion supplémentaire, et grave, qui consiste à réduire le langage à la communication. Et le langage est infiniment plus que de la communication. Le meilleur remède contre cette illusion massivement répandue, c’est que, heureusement, il y a des poèmes.
E.O. – Vous avez publié, collaboré aux Cahiers du Nouveau Commerce. Que représentait pour vous cette revue qui se voulait à juste titre une anthologie moderne de son temps.
H.M. ï€ C’est justement dans les Cahiers du Nouveau Commerce que j’avais publié mes trois premières traductions, Ruth, Paroles du Sage et le Chant des chants, des essais et des poèmes, jusqu’à la fin de cette revue, en 1996. C’était une très belle revue faite par Marcelle Fonfreide et André Dalmas, et elle continuait une tradition, celle de la revue Commerce des années vingt.
E.O – Une question qui m’intrigue toujours lorsque je lis l’œuvre d’un poète ou d’un écrivain. Quelle est votre famille d’esprit ?
H.M. ï€ Alors là je ne sais pas quoi répondre. Quelle est ma famille d’esprit ? D’abord, c’est une famille nombreuse. Je me vois comme quelqu’un qui ne sépare pas le langage et la vie, je me vois comme quelqu’un pour qui la vie, c’est d’abord les vivants. C’est ce qui commande tout le reste. Mes poèmes d’abord, et ensuite mes poèmes commandent mon travail de théorie du langage, et ma pratique et ma théorie de la traduction. Je me vois comme un marginal et un indépendant, faisant un travail critique sur ce qui a dominé dans la pensée du langage au XXe siècle. Depuis Platon. C’est pourquoi je passe pour un polémiste. Erreur, là encore. La critique c’est la liberté de penser. C’est l’analyse des historicités et des fonctionnements. La polémique, c’est le silence sur l’adversaire. Je sais, par expérience. Et, poétiquement, je me sens proche des dadaïstes, des futuristes russes et des expressionnistes allemands. Mais aussi de Dante, et de Brecht. Et j’aime l’humour. Rien ne me fait plus rire que le sérieux. Parce que je vois, et je m’amuse à reconnaître, que chaque savoir produit son ignorance, et ne le sait pas.
E.O. – Je voudrais vous poser une question plus personnelle. Vous êtes souvent venu donner des conférences en Israël, qu’est-ce que ce pays représente pour vous ?
H.M. ï€ Cela aussi c’est une question, je dirais à la fois facile et difficile. Une chose est sûre, c’est que pour moi ce n’est pas un pays comme un autre. Je m’y sens personnellement concerné. C’est un pays que j’aime, avec tous les problèmes qu’il porte, et le combat que cela suppose, contre toutes les formes d’antijudaïsme, d’antisémitisme, et la dénonciation à laquelle je travaille du nazisme dans l’islamisation du conflit israélo-arabe, et que le compassionnisme pro-palestinien ne veut pas voir. J’ai lu le livre de Yohanan Manor sur les manuels scolaires palestiniens, où on lit qu’on apprend à des enfants de trois ans comment faire un nez juif, avec le chiffre 6. Mon rapport à Israël implique pour moi un combat. Et pourtant, d’un autre côté, je ne suis pas en exil. Je ne peux que terminer sur le dicton yidich, s’ez schwer tzi seïn a yid. Et c’est quand tout allait bien que mes parents disaient, miz doch in gouless.
Esther Orner : écrivaine, traductrice; a publié : Autobiographie de personne, (Metropolis, Genève, 1999) ; Fin et suite, (Metropolis, Genève, 2001), Petite biographie pour un rêve (Metropolis, Genève, 2003), Une année si ordinaire (Metropolis, Genève, 2004) Petites pièces en prose très prosaïque (Editions Autres Temps, Marseille). De si petits secrets, (Metropolis, Genève, 2006). Elle vient de publier Récits grammaticaux et autres petites histoires (Metropolis, 2008). Elle vient aussi d’établir une anthologie de poétesses israéliennes traduites en français (éd. Caractères, 2008).
CONTINUUM NO.5
H.M. ï€ Poète, essayiste, traducteur. Oui il y a un ordre et en même temps tout interagit intérieurement. Mais pour autant que je me connais, je suis poète d’abord, et les poèmes que j’écris me font réfléchir sur la poésie, sur le langage, pour fonder la théorie du langage à partir des poèmes comme actes éthiques, qui transforment la théorie des sujets, par quoi aussi, pour moi, si un poème est d’abord un acte éthique, c’est aussi un acte politique, et ainsi la théorie du langage devient une poétique de la société. Et c’est l’écoute du poème qui me fait traduire comme je traduis, et spécialement la Bible. Ainsi toutes ces activités sont les aspects différents d’une seule et même activité, celle du poème.
E.O. –. Avant d’aborder d’autres questions, je voudrais vous demander de bien vouloir préciser deux points que vous venez d’évoquer
a- Un poème est d’abord un acte éthique
b- Le poème comme acte politique
H.M. ï€ Je pose que pour qu’un poème soit un acte poétique, il faut d’abord qu’il soit un acte éthique, parce que je comprends l’éthique comme ce qui met en jeu du sujet, le sujet, tous les sujets que nous sommes comme individus vivant ce que Spinoza appelle « une vie humaine ». Alors un acte éthique est ce qui met en jeu le sujet qui écrit de telle sorte que j’appelle poème une forme de vie qui transforme une forme de langage et, réciproquement, une forme de langage qui transforme une forme de vie. Donc un poème transforme celui qui l’écrit, mais aussi il transforme celui qui le lit. Toute la différence avec la poétisation.
Et comme nous sommes tous des sujets sociaux, nous sommes tous des sujets politiques, ainsi nécessairement un acte éthique est un acte politique, et le poème est un acte politique. Quand Maïakovski écrit un poème d’amour, alors que l’idéologie soviétique pose que l’amour est un sentiment bourgeois décadent, son poème est un acte poétique et politique. Et c’est Mandelstam en 1920, dans un article qu’il intitule « L’État et le rythme », qui dit que si on ne fait pas attention à l’individu on aura le collectivisme sans collectivité.
E.O. – Comment êtes-vous venu à l’idée de traduire la Bible. D’abord les cinq rouleaux et maintenant le Houmach, travail qui renouvelle entièrement la conception de la traduction du texte biblique
H.M. ï€ Question difficile pour moi justement parce qu’elle m’engage du plus profond de mon histoire individuelle, avec mon enfance traquée pendant la guerre, et paradoxalement (je dis paradoxalement parce que la Bible est un texte religieux et hyper-sacralisé) dans une famille non religieuse. Mais le besoin intérieur de réagir, et de me trouve, est passé par l’apprentissage individuel et tardif de l’hébreu biblique. J’ai dû commencer vers vingt ans, je n’y suis vraiment arrivé qu’à vingt-sept, quand j’étais soldat dans la guerre d’Algérie. Je suis un autodidacte et un amateur, pas un professionnel. Je n’arrête pas d’apprendre. J’ai ressenti un choc très fort en découvrant l’original, par rapport aux traductions. Et surtout quand j’ai découvert la grammaire des teamim, je ne me rappelle plus où, mais par bonheur j’ai d’emblée trouvé mon système d’équivalences typographiques pour les trois forces des accents disjonctifs, dès la première traduction qui a paru , c’est Ruth, au printemps 1966, puis Paroles du Sage en 1968 et Le chant des chants en 1969, avant Les Cinq Rouleaux de 1970. Et j’ai continué d’apprendre, avec les Taamei hamiqra de Baruch ben Yehouda (1968) et les deux traités, en anglais, de William Wickes (Ktav, New York, 1970). La visée, je l’ai ressenti tout de suite, c’est de faire entendre le poème de l’hébreu et l’hébreu du poème. Alors, si tout va bien, là j’ai fini bamidbar, et je vais me mettre à devarim, j’ai l’intention de traduire toute la miqra.
Et j’y ai appris des choses importantes, comme la différence entre le sacré, le divin et le religieux. Différence que ne font pas les religieux. Je définis le sacré comme le fusionnel entre l’humain et le cosmique, et incluant l’animal : le serpent parle à Ève ; le divin est le principe de vie (Genèse 1, 20-21) qui se réalise dans toutes les créatures vivantes ; le religieux n’arrive qu’avec vayiqra, c’est la ritualisation de la société (le calendrier des fêtes, les interdits, les prescriptions) et en tant que théologico-politique le religieux peut même être l’ennemi majeur du divin : on tue au nom de Dieu.
Et, ce qui a une importance telle que pour moi la Bible n’est pas une origine mais un fonctionnement, je trouve dans la Bible le fait, dès beréchit, que des mots abstraits comme « la vie » soient le pluriel du concret, « les vivants ». Je viens d’en faire tout un livre, où j’oppose le réalisme des essentialisations au nominalisme des individus d’abord.
E.O. ï€ J’aimerais vous poser quelques questions sur des lieux communs…
a- On a beaucoup parlé de Post-Moderne, je ne sais pas très bien ce que l’on entend par là. Qu’est-ce qui va venir après, Post post moderne ? Je m’imagine que vous avez une opinion là-dessus.
b- J’ai souvent entendu dire que la langue française était moins rythmée que d’autres langues. (J’y ai même cru un moment) Cela ne vous semble-t-il pas une absurdité ?
c- Autre lieu commun, la prose poétique (qu’est-ce ?) serait privée de rythme.
d- L’Internet, un danger pour la poésie.
H.M. ï€ J’ai déjà répondu sur le post-moderne, dans un livre de 1988 qui est ressorti en livre de poche en 2005, et que j’ai appelé Modernité modernité. La notion de post-moderne (à l’origine, en architecture, en réaction contre le modèle dogmatique du moderne), fait partie des déchets de l’époque, et s’est fondé sur l’erreur de croire que le moderne, c’était le nouveau, et que comme après chaque nouveau vient un nouveau nouveau, qui fait que l’ancien nouveau devient périmé, le post-moderne s’est dénommé ainsi contre la modernité des années vingt et après. La seule chose qui peut donc venir après le post-moderne, n’est pas un post post, mais comme toujours, des inventions de pensée et des inventions du regard, et celles-là, comme toujours, restent modernes, et j’entends par modernes actives et présentes au présent indéfiniment. Homère est moderne, des gloires d’il y a vingt ans sont du déchet de l’époque.
b – Le langage est un des domaines où il y a le plus d’idées reçues. L’art aussi. Et l’une des plus grosses erreurs est de croire que chaque langue a un génie, c’est-à-dire, des qualités naturelles, que n’ont pas les autres. Alors on croit que telle langue est plus belle qu’une autre, et a du rythme, par exemple, et d’autres, non.
La langue française est un domaine particulièrement riche en clichés culturels. C’est contre le cliché de la clarté française que j’ai écrit un livre, que j’ai appelé De la langue française, essai sur une clarté obscure (1997, en livre de poche en 2001). Il manque « le génie », exprès, dans le titre. Le génie est une nature. Or les langues sont une histoire, et une histoire qui est celle des discours, des œuvres. Croire au génie d’une langue, c’est attribuer à la langue ce qui est la propriété des discours, des œuvres. Ce sont les œuvres qui sont maternelles, pas les langues. C’est la Bible qui a fait l’hébreu – au sens de ce que l’hébreu est devenu, par la Bible – ce n’est pas l’hébreu qui a fait la Bible. Ce sont les valeurs éthiques, poétiques, politiques qui font une culture, et il ne faut pas attribuer à la langue ce qui est de la culture, et les deux, langue et culture, deviennent inséparables.
Et pour le rythme, on a souvent comparé le français aux autres langues européennes à accent de mot (anglais, allemand, italien, espagnol, etc.), pour dire qu’il n’a pas de rythme, parce que le français n’est pas une langue à accent de mot. Mais c’est une langue à accent de groupe, et donc les accents se déplacent. Si un mot fait un groupe, il a un accent de fin de groupe, si le même mot entre dans un groupe et n’est pas à la fin, il n’a plus l’accent qu’il avait quand il était équivalent à un groupe. De plus il y a les accents d’attaque consonantique. Et les accents d’insistance dans les répétitions, et les accents de position. Il y a le rythme comme organisation du mouvement de la parole, et il y a les rythmes, syntaxiques, prosodiques.
c – Quant à la prose opposée à la poésie, cette ineptie a une longue histoire, et qui n’est pas finie. L’identification culturelle de la poésie au vers, à la métrique, a produit deux erreurs. La première, mais il n’y a pas de hiérarchie, les deux ont cours en même temps, c’est qu’une identification du rythme à la métrique a fait croire, et continue de faire croire à certains que la prose n’a pas de rythme.
Cette illusion se nourrit de l’étymologie du mot vers et du mot prose en latin : le vers est le sillon du paysan qui revient sur lui-même, la prose est le discours qui va de l’avant. Cette première illusion vient du travail conceptuel de Platon, qui a transformé la notion pré-socratique de rythme, mouvement de ce qui s’écoule en continu, en une notion du discontinu, en ajoutant, pour penser la musique, les trois notions d’ordre (taxis), de mesure (metron) et de proportion mathématique (harmonia). Mais dans la réalité même de la prose, c’était faux, car les orateurs attiques avaient une métrique de prose, différente, bien sûr, de celle des fins de vers, et la prose latine avait aussi une métrique des fins de phrase, appelée cursus. Le paradoxe de cette première erreur est que les théoriciens français du XVIIIe siècle ne la font pas, et Shelley en 1817 dans A Defence of Poetry dit que c’est une « erreur vulgaire » d’opposer les écrivains en vers aux écrivains en prose. La deuxième erreur découle de la première et consiste à opposer la poésie à la prose. Le poème en prose, à partir du milieu du XIXe siècle, montre que la poésie ne peut pas, ne peut plus avoir une définition formelle par le vers. Mais cela, Aristote le savait déjà.
d – Je ne sais pas si je comprends bien la question. Autant que je sache, la technologie a un effet d’accélération fantastique de la communication. Avec évidemment des effets bénéfiques. Mais sans rapport avec la qualité de ce qui est communiqué, qui ne change donc rien, à part la vitesse, à ce qu’Ésope, dans l’antiquité grecque, disait de la langue, qu’elle peut véhiculer le meilleur comme le pire. Donc, à mes yeux, cela ne change rien. Sinon que cela apporte une illusion supplémentaire, et grave, qui consiste à réduire le langage à la communication. Et le langage est infiniment plus que de la communication. Le meilleur remède contre cette illusion massivement répandue, c’est que, heureusement, il y a des poèmes.
E.O. – Vous avez publié, collaboré aux Cahiers du Nouveau Commerce. Que représentait pour vous cette revue qui se voulait à juste titre une anthologie moderne de son temps.
H.M. ï€ C’est justement dans les Cahiers du Nouveau Commerce que j’avais publié mes trois premières traductions, Ruth, Paroles du Sage et le Chant des chants, des essais et des poèmes, jusqu’à la fin de cette revue, en 1996. C’était une très belle revue faite par Marcelle Fonfreide et André Dalmas, et elle continuait une tradition, celle de la revue Commerce des années vingt.
E.O – Une question qui m’intrigue toujours lorsque je lis l’œuvre d’un poète ou d’un écrivain. Quelle est votre famille d’esprit ?
H.M. ï€ Alors là je ne sais pas quoi répondre. Quelle est ma famille d’esprit ? D’abord, c’est une famille nombreuse. Je me vois comme quelqu’un qui ne sépare pas le langage et la vie, je me vois comme quelqu’un pour qui la vie, c’est d’abord les vivants. C’est ce qui commande tout le reste. Mes poèmes d’abord, et ensuite mes poèmes commandent mon travail de théorie du langage, et ma pratique et ma théorie de la traduction. Je me vois comme un marginal et un indépendant, faisant un travail critique sur ce qui a dominé dans la pensée du langage au XXe siècle. Depuis Platon. C’est pourquoi je passe pour un polémiste. Erreur, là encore. La critique c’est la liberté de penser. C’est l’analyse des historicités et des fonctionnements. La polémique, c’est le silence sur l’adversaire. Je sais, par expérience. Et, poétiquement, je me sens proche des dadaïstes, des futuristes russes et des expressionnistes allemands. Mais aussi de Dante, et de Brecht. Et j’aime l’humour. Rien ne me fait plus rire que le sérieux. Parce que je vois, et je m’amuse à reconnaître, que chaque savoir produit son ignorance, et ne le sait pas.
E.O. – Je voudrais vous poser une question plus personnelle. Vous êtes souvent venu donner des conférences en Israël, qu’est-ce que ce pays représente pour vous ?
H.M. ï€ Cela aussi c’est une question, je dirais à la fois facile et difficile. Une chose est sûre, c’est que pour moi ce n’est pas un pays comme un autre. Je m’y sens personnellement concerné. C’est un pays que j’aime, avec tous les problèmes qu’il porte, et le combat que cela suppose, contre toutes les formes d’antijudaïsme, d’antisémitisme, et la dénonciation à laquelle je travaille du nazisme dans l’islamisation du conflit israélo-arabe, et que le compassionnisme pro-palestinien ne veut pas voir. J’ai lu le livre de Yohanan Manor sur les manuels scolaires palestiniens, où on lit qu’on apprend à des enfants de trois ans comment faire un nez juif, avec le chiffre 6. Mon rapport à Israël implique pour moi un combat. Et pourtant, d’un autre côté, je ne suis pas en exil. Je ne peux que terminer sur le dicton yidich, s’ez schwer tzi seïn a yid. Et c’est quand tout allait bien que mes parents disaient, miz doch in gouless.
Esther Orner : écrivaine, traductrice; a publié : Autobiographie de personne, (Metropolis, Genève, 1999) ; Fin et suite, (Metropolis, Genève, 2001), Petite biographie pour un rêve (Metropolis, Genève, 2003), Une année si ordinaire (Metropolis, Genève, 2004) Petites pièces en prose très prosaïque (Editions Autres Temps, Marseille). De si petits secrets, (Metropolis, Genève, 2006). Elle vient de publier Récits grammaticaux et autres petites histoires (Metropolis, 2008). Elle vient aussi d’établir une anthologie de poétesses israéliennes traduites en français (éd. Caractères, 2008).
CONTINUUM NO.5